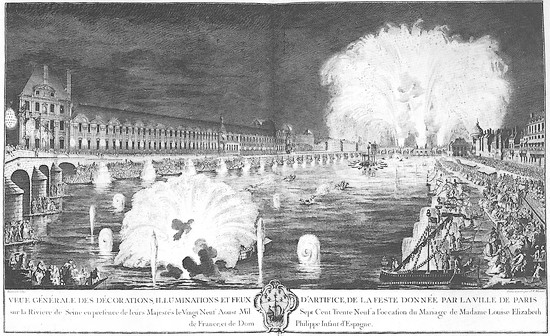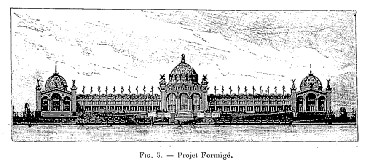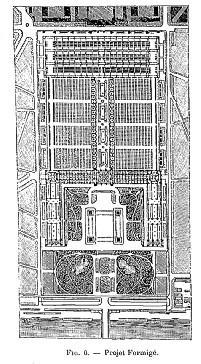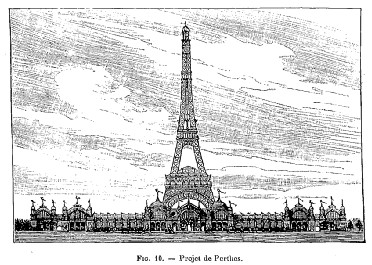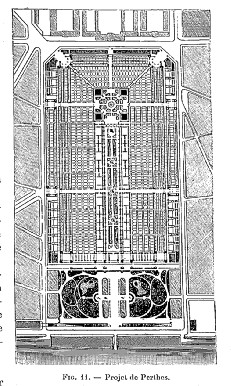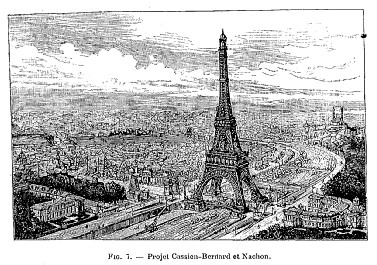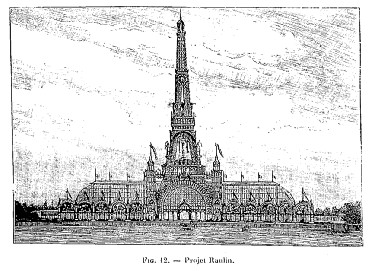Les métiers de Paris sous l’ancien Régime : les Orfèvres
« L’orfèvre a été à toute époque le premier ouvrier de Paris. Au XIIIe siècle, le Livre des Métiers, qui n’admet pas de hiérarchie parmi les communautés, laisse entrevoir, dans le style de leurs règlements, l’excellence unique de ce travail réservé aux princes et à l’Église. Au XVIIIe siècle, parmi les négociants des Six Corps, c’est le seul corps composé de fabricants. Type spécial, participant de l’artiste, de l’ouvrier et du grand négociant, l’orfèvre a; toujours maintenu sa haute supériorité non pas autant par sa richesse que par la noblesse de son métier.
On a lu les statuts des orfèvres dans le Livre des Métiers. Rédigés en douze articles très brefs,
ils semblent destinés à complaire au prévôt de Paris plutôt qu’à fixer les règles de la communauté. Ils prescrivent la qualité d’or qui doit être à la touche de Paris, la première du monde entier, et le titre de l’argent qui est celui du sterling. Les privilèges les plus étendus leur sont accordés. La confrérie de Saint-Eloi, déjà prospère, consacre une partie de ses fonds à donner des repas aux pauvres et aux malades.
Le roi Jean, en 1355, et Charles V, en 1379, leur donnèrent un nouveau texte de règlements. Jusque-là on ne les cite que pour des mesures d’ordre public, interdiction de faire le change dans leurs comptoirs du Grand Pont, défense de fabriquer de la vaisselle d’or et d’argent pendant un an, prescriptions souvent illusoires que motivait la rareté des métaux précieux dans les circonstances critiques. Les statuts de 1355 et de 1879 sont un même texte. On y retrouve les formules d’Etienne Boileau avec plusieurs règlements nouveaux et plus précis concernant l’emploi de l’or et le sertissage des pierres, mais dans les citations de ces objets, quelques expressions restent encore obscures et incertaines.
L’administration de la communauté passa de trois à six jurés, nombre qui ne fut plus dépassé, même dans les temps modernes (1). La maîtrise était encore libre, à la condition d’avoir fait huit ans d’apprentissage, de subir une épreuve devant les maîtres et d’avoir un poinçon à contreseing, difficultés équivalant à peu près à l’exclusion pour tout autre que les fils de maître. La confrérie de Saint-Eloi, mieux définie pour l’époque, percevait la moitié du prix de maîtrise des étrangers et le cinquième des amendes pour le banquet annuel qu ‘elle donnait à l’Hôtel-Dieu.
L’or doit être à la touche de Paris. Le type de l’argent est appelé «argent le Roy “, à onze deniers douze grains le marc. Les rubis, grenats, émeraudes, améthystes, sont sertis sans feuille dans le fond; les perles d’Orient ne sauraient être mélangées avec les perles d’Ecosse, plus communes. Pour les pierres comme pour le titre de l’or, on admet une tolérance ou, comme on disait alors, ” un remède », au sujet des joyaux d’église qui atteignent souvent de grandes dimensions.
Ces côtés techniques du métier, que nous indiquons seulement, sont décrits avec assez de détails dans les statuts; ils ont d’ailleurs peu varié, le travail de l’orfèvre ayant atteint son perfectionnement dès l’origine et ne permettant pas par lui-même plusieurs manières de procéder.
L’usage fréquent des objets d’or pour la toilette et la coiffure, principale spécialité des merciers, avait obligé les orfèvres à les reconnaître comme marchands d’orfèvrerie. Les merciers étaient définitivement établis en communauté depuis les statuts de 1324. On leur permet la vente des objets en or plein, mais non des objets dorés, l’application de la dorure étant plus susceptible de fraude. Une discussion éclata entre eux et aboutit, en 1429, à un procès qui fixa les parties. Il s’agissait de ceintures d’or et d’argent saisies chez les merciers pour faute d’aloi. Le Parlement, dans l’arrêt qu’il rendit, leur imposa des règlements plus précis et surtout plus rigoureux. Les merciers, déjà très influents, se maintinrent désormais dans le commerce des matières d’or que les orfèvres ne réussirent pas à leur enlever.
La valeur de l’or exigeant d’infinies précautions, les statuts particuliers ne suffisaient plus, et l’intervention directe de l’autorité fut reconnue nécessaire pour l’observation des lois. Déjà en 1421, nous voyons les orfèvres soumis à l’inspection des maîtres généraux des monnaies; puis l’arrêt de 1429 maintient la même décision en l’accompagnant de règlements. Toutes les pièces devront être marquées du poinçon particulier de chaque orfèvre, une fleur de lis couronnée avec ses initiales, puis contremarquées du poinçon de la communauté M. Les maîtres généraux des monnaies seront chargés de présider à la réception à la maîtrise, de prendre de chaque nouveau maître une caution de dix marcs d’argent, de faire la visite des ouvrages d’orfèvrerie. On y voit encore la division des orfèvres en « grossier et mennuyer », selon leurs spécialités et la première mention précise d’un chef-d’oeuvre.
L’administration royale n’imposa les statuts aux métiers, comme règle générale, que dans la seconde moitié du XVIe siècle, après les grands édits. Il y a lieu d’observer que les orfèvres ont précédé les autres de plus d’un siècle, en,raison de la valeur exceptionnelle et de l’emploi surveillé des matières d’or ; dès 1421, la juridiction de la Cour des monnaies leur fut prescrite. Ils gardèrent seulement l’élection de leurs jurés à faire au Châtelet ; les élus allaient ensuite prêter serment à la Monnaie. De nombreux arrêts, jusqu’au milieu du XVIIIe siècle, tous rendus dans le même sens, leur permirent de conserver ce privilège, dernier vestige de leur ancienne indépendance ouvrière.
Après quelques sentences relatives à la fabrication, vint une ordonnance de Louis XII, en 1504, prescrivant l’inscription sur un registre des objets vendus, avec mention à part du prix du métal et du prix de la façon. Cette sage mesure, énoncée pour la première fois, fut appliquée pendant longtemps.
François Ier confirme, en 1534 , les.statuts donnés par le roi Jean et, quelques années après, en 1543, sur les remontrances faites aux maîtres, généraux des monnaies, il promulgue un nouveau texte de règlements pour l’orfèvrerie, à Paris et dans le royaume. Cette ordonnance, en forme de statuts, vise tous les points du travail et de l’organisation intérieure de la communauté, mais au lieu de revêtir le caractère d’une délibération particulière des maîtres orfèvres, simplement sanctionnée par le pouvoir, elle prend la forme impérative des édits, terminant chaque article par les termes consacrés « statuons et ordonnons ». C’est le signe encore plus marqué de l’ingérence directe de l’administration dans les affaires privées des communautés. Les statuts requis par les ouvriers ne sont plus simplement revêtus de l’homologation, ils sont réglés et commandés sans apparence de discussion.
L’or, à 22 carats, sera vendu de 149 à 163 livres le marc, en comptant la façon en sus. Tout or inférieur à 21 carats sera cassé. L’argent sera à 11 deniers 12 grains le marc, titre de Paris. L’essai de l’aloi aura lieu à la pierre de touche et au besoin à l’eau-forte. Si l’acheteur fournit son or, il ne donnera jamais à fondre des pièces de monnaie. Tous les marchands d’objets d’or, merciers ou autres, devront les faire fabriquer par les orfèvres. Les maîtres orfèvres continueront à émailler leurs ouvrages de toutes sortes d’émaux, à leur entière convenance, comme ils pouvaient déjà tailler les pierres précieuses, absorbant à leur gré ces deux métiers : celui d’émailleur, non établi, et celui de lapidaire, aussi ancien qu’eux. L’apprentissage reste fixé à huit ans, et pour les maîtres étrangers on exige en outre un travail de trois années avant de pouvoir obtenir la maîtrise de Paris. Enfin, pour la délicate question des visites, le Roi ordonne qu’elles seront encore faites par les gardes naturels de la communauté, mais à la condition d’être contrôlées par les maîtres généraux des monnaies.
L’ordonnance de Henri II, de 1550, sur la monnaie, renouvela les prescriptions qui précèdent; elle insista surtout sur l’inscription des noms de l’acheteur, titre de l’or, .prix et qualité, pour permettre de suivre la trace des objets. Les orfèvres, inquiets des conséquences de cet acte qui étendait encore les attributions de la Cour des monnaies en lui soumettant tous les métiers de l’or, obtinrent en 1552 un arrêt qui maintenait le serment de leurs jurés au Châtelet.
Cette ordonnance, générale pour la France, reçut une application directe aux orfèvres de Paris, par lettres de, Henri II, du 22 mai 1555. Ce sont de véritables statuts, se rapportant à ceux de 1543, en adoucissant toutefois la rigueur de certains points. On n’exigera plus l’inscription des noms des acheteurs, mais seulement la mention des objets vendus..Les aspirants devront savoir lire et écrire, sauf exception motivée. Les orfèvres pourront plaider personnellement leurs, causes devant la Cour des monnaies, sans avocat ni procureur. Le nombre des maîtres restera fixé comme actuellement (ce devait être trois cents), et il sera procédé au remplacement par extinction, sauf création de six maîtres par an choisis de préférence parmi les fils de maître; toutes lettres de don cesseront d’être valables.
Les lettres de 1555 sont une sorte de satisfaction donnée aux orfèvres(1); l’administration de Henri II cherchait à concilier l’indépendance privée d’une communauté aussi honorable avec les exigences de la Sûreté publique qui réclamait une répression sévère contre la fraude sur les métaux précieux.
Après divers arrêts d’un intérêt secondaire, les orfèvres voient leur communauté atteinte par les grands édits sur les maîtrises, qui débutèrent par celui de décembre 1581. Principalement destinés à procurer des ressources au Trésor sous forme dé prix de maîtrise, ces édits bouleversèrent l’ordre établi pour les réceptions; les jurés furent impuissants,contre l’abus des lettres données en dehors d’eux par le pouvoir. Cependant les orfèvres parèrent à l’avilissement de leur métier avec les lettres patentes de 1584 et 1697, qui chacune arrêtaient l’effet des édits, en déclarant nulles et non avenues toutes maîtrises de lettres non agréées par l’assemblée de la communauté.
Les luttes extérieures ne faisaient pas oublier les règlements d’ordre privé. En 1699, des lettres de Henri IV approuvent une modification dans les statuts: l’apprentissage ne commencera ni avant dix ans ni après seize ans; il durera huit années entières, sans compensation aucune, contrairement aux anciens statuts qui accordaient un bénéfice à l’apprenti capable de faire gagner cent sols par an à son maître, tous frais payés (2). C’était toujours dans un but d’élimination des étrangers. On renouvelle la défense de prêter le poinçon et de vendre des pierres fausses, prescriptions dirigées contre leurs puissants rivaux les marchands merciers. »

———————————————————————-
Source :
Titre : Les métiers et corporations de la ville de Paris : XIVe-XVIIIe siècles. Ordonnances générales, métiers de l’alimentation / par René de Lespinasse,…
Auteur : Lespinasse, René de (1843-1922)
Éditeur : Imprimerie nationale (Paris)
Date d’édition : 1886-1897
Contributeur : Bonnardot, François. Directeur de publication
Sujet : Métiers — France — Paris (France)
Sujet : Corporations — France — Paris (France)
Type : monographie imprimée
Langue : Français
Format : 3 vol. : fig. et planche ; in-fol.